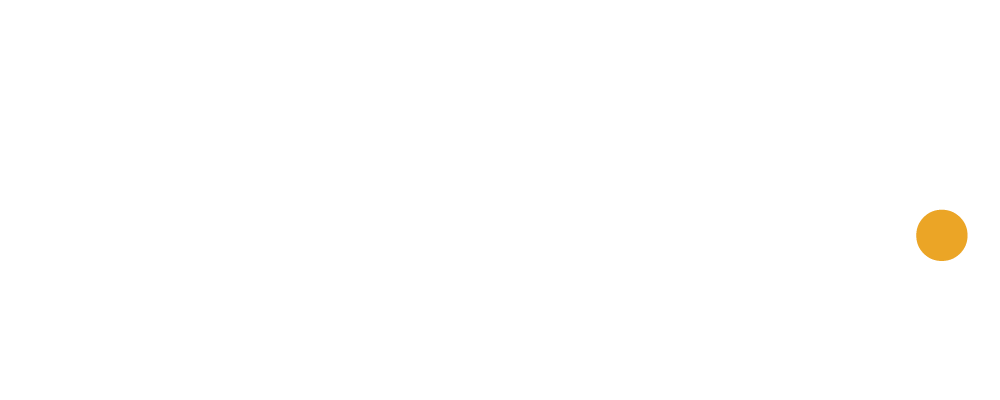COACHING DE GESTION
transformez le leadership
conjuguer des équilibres
Démystifier le coaching
Le coaching révèle ce qui se cache derrière les apparences, les autres perspectives. Ainsi, ce partenariat présente un dialogue authentique entre un coaché et son coach. Un espace où elle peut explorer ses ambitions sans filtre et transformer ses intentions en actions concrètes. Surtout, un environnement d’exploration et d’expérimentation pour définir son pouvoir d’Être et comprendre son pouvoir d’Agir.
Choisir un coach, c’est accepter de bousculer ses habitudes et reconnaître qu’on veuille dépasser ses limites actuels.
Les coachés demeurent maîtres de l’aventure et définissent leurs priorités. Ils prennent des décisions plus alignées avec leurs valeurs, avec clarté et cohérence.
Les dirigeants, entrepreneurs, cadres et professionnels qui s’entourent d’un coach découvrent une approche différente.
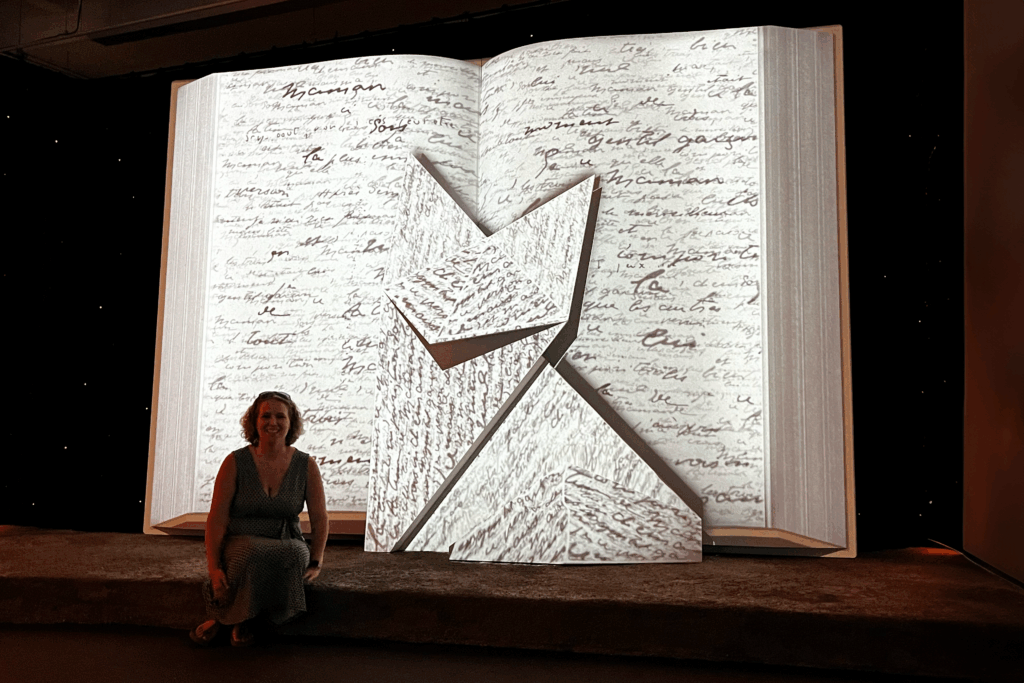
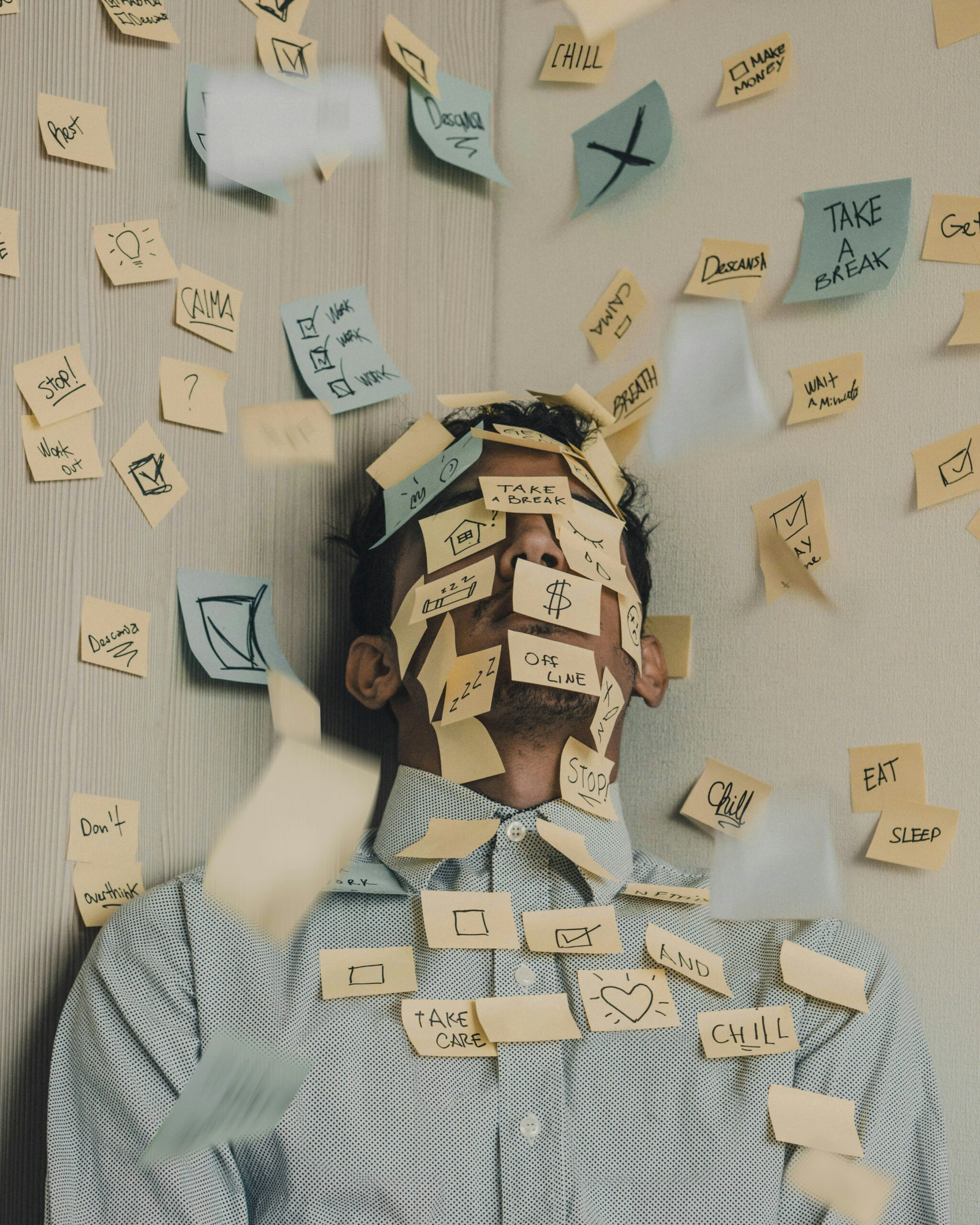
RÉFLECHIR TOUT HAUT. RÉFLÉCHIR ENSEMBLE.
Je mise sur la créativité, l’exploration des possibles et une posture un brin disruptive. J’apprécie jouer avec des images et des canevas pour explorer et co-designer à partir de réflexion et d’outils adaptés à la réalité individuelle.
Mon coaching est influencé par les pratiques de coaching traditionnelles, et aussi, le design thinking.
Je m’adapte aux besoins, ici et maintenant. J'aime aussi changer physiquement de perspective pour avoir un impact sur l'esprit.
Je mets mon expérience, mes compétences et mon réseau au service de mes partenaires. Chaque coaché mérite une attention particulière.
Être choisi comme coach représente un honneur qui se gagne chaque jour, demeurée un partenaire de réussite. L’objectif va au-delà des résultats professionnels. Être bien avant d’être bon, c'est aussi de conjuguer avec des équilibres.
des valeurs mises en avant
C’est ce que j’ai envie d’incarner et de partager: reconnecter les dirigeants à leurs valeurs profondes pour qu’ils puissent incarner un leadership authentique et cohérent.
J’aurais pu ajouter Amour et Courage. Je crois seulement qu’elles deviennent témoin de toute relation, et non seulement moteur d’action.
Authenticité
Être vrai, décomplexé des attentes, des masques et des mécanismes de notre personnalité.
Avoir le courage de ce voir au delà du reflet, au delà du mental, dans notre pouvoir d'être ici et maintenant.
Créativité
Explorer l'incertitude et l'inattendu avec des idées disruptives. Après tout, nous sommes les créateurs de notre vie, alors soyons mettre des (im)possibles et animer par notre magie.
Liberté
Choisir. Arrêter. Commencer.
r
Permettre à chacun de devenir maître et responsable de son aventure.
«Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités»
— Ben Parker
Partenariat
Avancer ensemble, côte à côte, co-créateur.
Une relation d'égal à égal où le coach devient un allié stratégique qui observe et accompagne sans diriger.
stratégies de coaching professionnel
Développement professionnel
Reconnecter la personne à son plein potentiel pour qu’elle puisse agir avec justesse, fluidité et impact.
Les blocages sont abordés sans détour. On confronte la procrastination, on formule des requêtes audacieuses et on provoque des prises de position courageuses.
Transformation
Le changement commence par la conscience. On augmente le niveau de conscience sur ce qui se vit, ce qui bloque et les conséquences du statu quo.
On explore les états intérieurs actuels et désirés. La transformation s’enclenche un petit pas à la fois, avec des gestes simples et significatifs.
Sécuriser une transition de rôle en incarnant un leadership aligné, clair et cohérent, dès l’entrée en fonction.
Plus le leader s’aligne avec qui il est et avec le système qu’il intègre, plus il devient capable de générer un impact juste pour lui, pour son équipe, pour son organisation.
Prêt à empuissancer
ton plein potentiel?
INTENTION DE COACHING
Complète ce questionnaire qui aidera à cible tes attentes, tes perturbations et facilitater la co-création d’une stratégie de coaching aligné avec ton intention.