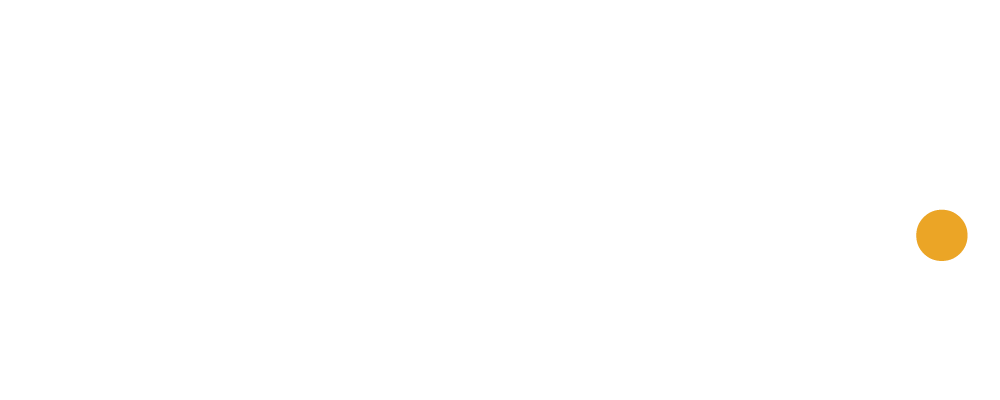Le piège invisible de la dépendance
Stephen Covey enseigne que nous évoluons naturellement de la dépendance vers l’indépendance, puis vers l’interdépendance. Quel cadeau j’ai reçu pour mes 40 ans! 😅Pourtant, trop souvent, l’aide nous ramène vers la dépendance sans que nous nous en rendions compte. L’aidant, animé des meilleures intentions, voit ce que l’aidé ne perçoit pas encore, comprend plus rapidement la situation et agit en conséquence. Cette dynamique, bien qu’elle parte d’une bonne intention, finit souvent par bousculer l’aidé dans ses capacités réelles et ses compétences perçues. Finalement, peu se sentir assez vite démuni. Le résultat? L’aidé reste dans une posture d’incompétence et développe une dépendance plutôt qu’une autonomie renforcée. (Après on dit qu’on veut que les gens soient plus responsables, imputables…)
On m’a transmis trois postures distinctes à observer qui définissent la qualité de l’aide apportée.
Le «faire pour» où l’aidant prend entièrement la responsabilité du problème (risque d’être un sauveur), laissant l’aidé dans une position passive et dépendante (à moins d’une délégation précise et consciente… alors est-ce de l’aide ou une délégation. J’y réfléchis encore). Cette approche, bien qu’elle puisse sembler efficace à court terme, prive l’aidé de l’opportunité d’apprendre et de développer ses propres capacités.
Le «laisser faire» représente l’autre extrême, celui de l’autonomie totale. Cette posture n’est ni bonne ni mauvaise en soi; tout dépend de l’intention qui la guide et de la qualité de la communication qui l’accompagne. Elle peut être appropriée quand l’aidé a besoin d’espace pour expérimenter, mais elle peut aussi être perçue comme de l’isolement si elle n’est pas bien comprise. C’est aussi parfois un bel espace de lâcher-prise pour l’aidant…
Le «faire avec» incarne l’interdépendance qui nourrit beaucoup ma conscience. C’est la création d’un espace de partenariat et de co-création qui vise l’empuissancement conscient de l’aidé. Dans cette dynamique, l’aidé reste pleinement responsable de son succès tout en recevant des effets de levier de l’aidant, et ce, en parfaite synchronicité avec sa capacité de réceptivité et d’intégration.
Le succès de toute demande d’aide repose sur plusieurs éléments interconnectés qui forment un écosystème de communication. Il y a d’abord l’attente transmise par l’aidé, puis le message effectivement reçu par l’aidant. S’ajoutent l’écoute réelle de l’aidant, sa capacité effective à aider, la synchronicité entre les deux personnes, et finalement la capacité de l’aidé à recevoir tant la réponse que l’aide offerte. Quand un de ces éléments fait défaut, toute la dynamique peut s’effriter.
Finalement, ça peut bien être normal d’avoir de la difficulté à demander de l’aide. Sommes-nous entrainer à demander? Aussi bien que de répondre à la demande…
Comment évoluer vers l’interdépendance
Pour passer du «faire pour» au «faire avec», l’aidé a d’abord l’opportunité de se responsabiliser et de communiquer clairement ses attentes. Il peut s’offrir une demande claire : «J’ai besoin qu’on fasse avec moi. Je suis à cette étape. Je cherche tel rythme et je désire passer par telle voie.» plutôt que de laisser l’aidant choisir ses besoins réels. Cette démarche exige de l’aidé qu’il fractionne son besoin, qu’il le structure, qu’il définisse le minimum requis qui créera un point de bascule vers son indépendance, et qu’il soit conscient de ses propres limites en regard de sa capacité et de son individualité.
L’aidant a une aussi un part importante de responsabilité, pour viser une co-responsabilité. Écouter, respecter, rythmer, dans une posture totalement dévouée et empathique. C’est-à-dire, pas en fonction de ses croyances, et plutôt, en ayant confiance en l’aidé et le laissant guider. Souvent, l’aide est guidé par une perception personnelles où nos propres mécanismes. Malheureusement, l’égocentrisme altère la qualité de l’altruisme.
Quand la confiance s’installe entre les deux parties, cette communication devient fluide et l’aidé peut ajuster sa demande selon l’évolution de ses besoins. Il peut l’accroître, la ralentir ou la retirer avec harmonie et bienveillance, toujours en cohérence avec lui-même et son besoin véritable.